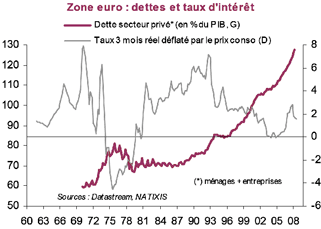
4-1743/1 | 4-1743/1 |
1er AVRIL 2010
1. Les multiples causes de la crise
« Personne n'a vu venir cette crise », nous dit un ancien président d'une grande banque belge. Pourtant il y a eu 124 crises bancaires dans le monde depuis 1970, soit plus de trois par an. Des pays comme l'Italie, la Finlande, les États-Unis, la Norvège, la Suède ont été touchés au cours des trois dernières décennies. Les crises bancaires ne sont pas des événements fortuits, mais récurrents. Mais ce qui distingue cette crise des 123 précédentes, c'est son ampleur et sa brutalité.
Beaucoup d'encre a coulé pour décrire le mécanisme de la titrisation des crédits subprimes américains. Les dépréciations sur ces titres, qui ont été achetés par de nombreuses banques à travers le monde, les touchent très durement. Par ce biais des banques belges ont en réalité financé l'achat d'habitations aux États-Unis plutôt que de financer l'économie belge avec l'épargne des ménages. À l'ère de la finance globalisée, les banques sont liées les unes aux autres car elles se prêtent des fonds sur le marché interbancaire et achètent des titres émis par des consœurs (titres subprimes pour ne citer que ceux-là). Lorsqu'une banque éprouve des difficultés financières importantes, l'ensemble du système bancaire est alors mis sous pression. C'est la logique de la mondialisation de la finance, ou de la circulation sans entrave des capitaux, qui est à l'œuvre. Ses effets peuvent être dévastateurs.
Pourtant la mondialisation de la finance n'est que le catalyseur de la crise, elle ne fait qu'accélérer et amplifier les crises. Les causes réelles sont bien plus profondes. La crise actuelle est une crise généralisée de l'endettement qui provoque une crise généralisée de la demande. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'endettement du secteur privé (ménages et entreprises) a plus que doublé au cours des quarante dernières années dans les pays de la zone euro.
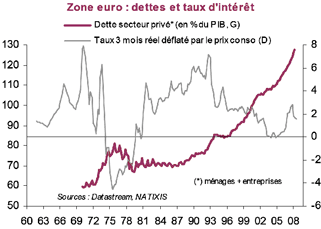
Cet endettement est la conséquence d'une stagnation des revenus des ménages. Comme l'illustre le graphique ci-dessous, les salaires réels ont augmenté en moyenne plus lentement que les gains de productivité depuis 1978 dans les pays de la zone euro. Les ménages ne gagnent plus assez pour acheter les produits qu'ils produisent et sont donc obligés de s'endetter pour maintenir leur train de vie.
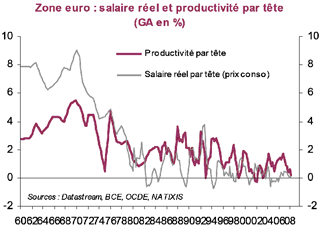
L'endettement est évidemment problématique puisqu'il réduit la part du revenu disponible à la consommation (les charges d'intérêt diminuent la part du revenu disponible). À long terme la demande des ménages s'est érodée.
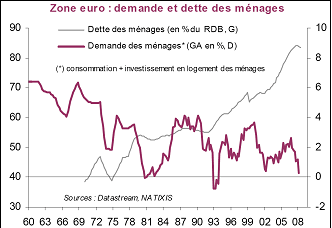
Cette augmentation sensible de l'endettement s'observe dans tous les grands pays industrialisés. Les pays anglo-saxons sont encore plus durement touchés parce que la paupérisation relative et absolue y est encore plus forte qu'en Europe continentale.
Les auditions de la Commission spéciale ont permis d'identifier un autre facteur clé des crises financières, à savoir l'avidité. Lorsque la fièvre de l'appât du gain affecte les banquiers les conséquences sont beaucoup plus graves, car l'ensemble des acteurs économiques en subissent les conséquences. Afin d'augmenter artificiellement leur rentabilité les banques se sont endettées de manière exagérée. C'est le recours à ce que l'on nomme le levier d'endettement. Concrètement, elles ont emprunté des fonds sur les marchés de capitaux pour les investir dans des produits très rentables. Pour l'achat de ces produits financiers les banques se sont fiées aveuglément aux ratings que donnaient les agences de notation. Un ancien président d'une grande banque belge bradée à l'étranger résume parfaitement l'état d'esprit qui régnait il n'y a pas si longtemps dans le milieu de la banque: « Tout le monde a acheté des produits structurés et tout le monde se fiait aveuglément aux ratings des agences de notation. Personne ne faisait l'évaluation de ces produits. » Le problème, que personne ou presque n'a soulevé à temps, est que les agences de notation étaient payées par les émetteurs de ces produits pour dire qu'ils étaient d'excellente qualité. Ce conflit d'intérêt béant a pesé sur la qualité de ces évaluations externes. Les banques se sont endettées pour acheter des produits sans en analyser elles-mêmes le risque. Cette conduite hautement spéculative s'est avérée ruineuse pour les banques et pour les États qui ont dû les secourir. En somme, les banques belges ont prêté de l'argent à des ménages américains insolvables (selon les normes belges ces gens auraient été repris sur la liste des mauvais payeurs de la banque nationale) plutôt que de prêter de l'argent aux ménages et aux entreprises en Belgique. Une telle situation est inacceptable et ne doit en aucun cas se reproduire.
La combinaison des règles comptables et des règles de solvabilité des banques a également amplifié la crise. Comme le déclarait un directeur général d'une grande banque belge lors de son audition par la commission spéciale, « les règles comptables et les normes de Bâle II ont un effet procyclique trop important. Je n'étais absolument pas demandeur de ces normes car elles augmentent la volatilité du compte de résultats ». En effet, les banques qui détiennent des actifs financiers (actions, obligations) dont la valeur s'apprécie enregistrent des bénéfices et peuvent distribuer des dividendes, alors qu'elles n'ont réalisé qu'un bénéfice virtuel (tant qu'elles n'ont pas vendu ces actifs la plus-value n'est que virtuelle). Lorsque la conjoncture économique se dégrade et que les marchés financiers subissent des revers, les banques sont obligées d'enregistrer des moins-values sur leurs portefeuilles de titres. Les normes de Bâle II renforcent ce caractère procyclique, car l'exigence des fonds propres des banques dépend de la qualité des produits financiers en portefeuille telle que mesurée par les ratings des agences de notation. Lorsque les marchés financiers sous-estiment les risques, les banques peuvent donc réduire leurs fonds propres jusqu'à peau de chagrin. En revanche, lorsque les ratings sont revus à la baisse (dégradation d'un rating AA à B par exemple) les banques sont obligées d'augmenter fortement leurs fonds propres dans un contexte où plus personne ne veut ou ne peut apporter ces fonds nécessaires.
En somme, les banques se sont écartées de leur métier de base qui est le financement de projets de particuliers et d'entreprises pour se livrer à des activités spéculatives en apparence plus rentables. Aujourd'hui l'ensemble de l'économie en fait les frais. Les banques sont obligées d'enregistrer des pertes sur ces actifs qui perdent rapidement de la valeur (le non-remboursement partiel des dettes titrisées entraine une réduction de valeur des titres concernés) et de se désendetter rapidement. Échaudées par cette mésaventure les banques sont devenues excessivement prudentes et durcissent les conditions d'octroi de crédit aux entreprises et aux ménages.
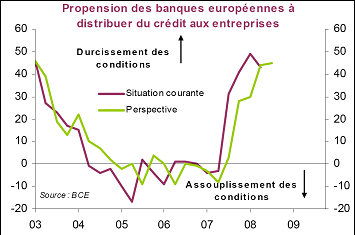
Les ménages et les entreprises anticipent aussi des difficultés économiques et réduisent leur demande de crédits. Dans cette période de grande incertitude, tous les acteurs privés tentent de se désendetter et d'épargner davantage. On voit donc une diminution assez prononcée des crédits octroyés en raison d'une baisse conjointe de l'offre et de la demande de crédits. Ce phénomène aggrave encore la crise.
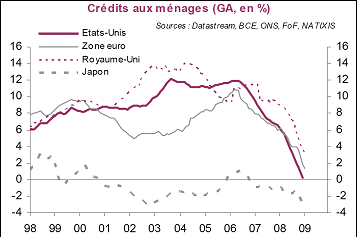
Nous assistons donc à la naissance d'une spirale de désendettement et de déflation qui risque d'avoir des conséquences catastrophiques. La déflation augmente le poids de la dette et la rend plus difficile à rembourser (les taux réels augmentent malgré la baisse des taux nominaux, les revenus baissent alors que les dettes ne diminuent pas). Pour éviter ce scénario de la grande dépression des années 1930, les États injectent massivement des liquidités dans le système et mettent en œuvre des plans de relance économique. Une augmentation de l'endettement des États est donc inéluctable pour absorber le désendettement des acteurs privés.
2. Les responsabilités des acteurs
Le système financier autorégulé a failli. Le cadre réglementaire n'a pas été conçu pour rendre le système financier plus sûr, mais pour permettre aux acteurs financiers de faire des bénéfices toujours plus grands. Les responsabilités sont largement partagées dans le monde de la finance. Les banquiers, les agences de notation, les superviseurs et les politiques ont tous fauté.
Les banquiers ont adopté des stratégies privilégiant « la rentabilité et la croissance en veillant à respecter la lettre mais non l'esprit de la réglementation » (1) . À cet effet, elles ont investi dans des produits sans en mesurer les conséquences et ont mis l'épargne des ménages en danger. Les banques se sont aussi endettées démesurément pour acheter ces produits financiers. Le levier d'endettement moyen (total du bilan/fonds propres) sur la période 2004-2008 était de 36 pour Fortis, 33 pour Dexia et 19 pour KBC. Ces leviers sont clairement excessifs, en particulier pour les deux premier cas. Les dirigeants des banques n'ont clairement pas fait preuve du discernement nécessaire à la gestion d'une telle entreprise.
Pour leur défense, il faut reconnaitre que leur mode de rémunération ne les incitait pas à la modération et à la réflexion. Les bonus et stock-options ont incité les patrons des banques à poursuivre des rendements excessifs en prenant des risques démesurés. Il est inquiétant de constater qu'aujourd'hui encore certains banquiers refusent d'admettre leurs fautes et empochent sans la moindre vergogne des bonus et primes de départ plantureux, alors que leur bilan est calamiteux.
Les agences de notation privées ont également failli en n'évaluant pas correctement les produits financiers. Une des principales raisons est le conflit d'intérêt manifeste auquel elles sont confrontées, puisqu'elles sont payées par les émetteurs de produits financiers qui demandent ces notations. Ces agences jouissent également d'un quasi monopole mondial dans ce métier puisqu'à trois (Moody's, Fitch, Standard & Poors) elles représentent 90 % du marché mondial.
Les superviseurs n'ont pas mis fin à cette orgie spéculative, faute de volonté et de courage. Contrairement à ce que les superviseurs ont prétendu lors des auditions de la Commission chargée d'examiner la crise financière, ils ont les moyens d'empêcher les banques de commettre certains excès. En Belgique, la CBFA a de nombreuses missions et les moyens de les exercer. Une de ces missions est de veiller à la situation financière des institutions financières (banques, assurances, organismes de placement, etc.). À cet égard, la CBFA a le pouvoir de rédiger des règlements dans lesquels elle peut fixer des normes détaillées de solvabilité, de liquidité et de limitation du risque qui s'imposent aux banques (2) . La CBFA peut imposer à une banque un niveau de fonds propres plus élevé (levier moins élevé) que celui qu'elle détermine selon les règles de Bâle II (3) . Au niveau du besoin de liquidités des banques nous sommes également interpelés par la passivité de la CBFA. Le responsable de l'audit interne de Fortis a clairement déclaré à la Commission spéciale qu'une série de rapports négatifs avaient été remis depuis 2003 sur la gestion de liquidités chez Fortis et que ces rapports ont conduit à une inspection de la CBFA en 2005. Face à ces multiples constats, on est en droit de se demander pourquoi la CBFA n'a rien entrepris pour limiter le levier d'endettement et le besoin de liquidités des banques belges ? Y-a-t'il une proximité trop grande avec les institutions financières en raison de la confusion des carrières ? Où est-on face à ce qu'on pourrait appeler le « complexe de Greenspan » du nom de l'ancien Président de la réserve fédérale américaine, selon lequel le régulateur est convaincu que l'autorégulation de la finance le dispense de toute intervention ?
Les politiques ont quant à eux apporté les transformations au système financier que les spéculateurs leur ont demandé. Les accords de Bâle II, qui sont des accords entre banques privées sur les exigences de fonds propres, ont été validés par la directive européenne CRD. L'assouplissement, voire la suppression, de la séparation des métiers bancaires héritée de la crise de 1929 est un autre exemple (assouplissement des règles de type « Glass-Steagall Act »).
Le gouvernement belge a également sa part de responsabilité en raison de sa gestion amateuriste et précipitée de la crise. Contrairement à ce qu'il prétend, les problèmes ne sont pas apparus d'un coup le 26 septembre 2008, mais étaient en gestation depuis des mois (la CBFA suivait la crise de liquidité depuis août 2007) et que la situation était déjà devenue critique depuis le 16 septembre 2008. Le sauvetage de Fortis a été un cafouillage du début à la fin. Alors que des pays voisins ont adopté des législations de crise permettant d'intervenir plus rapidement et efficacement en cas de crise (nationalisation d'une banque) et d'éviter les procédures judiciaires intentées par les actionnaires, notre gouvernement n'a rien fait de tel. Il n'y a ce jour pas de procédures standardisées pour encadrer le sauvetage de banques, alors qu'il s'agit d'une recommandation de plusieurs organisations internationales. Par ailleurs, plutôt que de garantir les pertes sur les produits toxiques de Fortis et Dexia, l'État belge aurait dû racheter les actifs sains et les dépôts des banques pour constituer une ou plusieurs « good banks » (bonnes banques). Cela aurait été une option plus intéressante pour les contribuables qui ne sont en rien responsables de la crise actuelle et qui doivent pourtant assumer financièrement les déboires des banques.
Le système financier fonctionne de manière irrationnelle. En période faste, la confiance excessive des financiers les incite à prendre des risques excessifs. En revanche, lorsque le climat économique est moins bon, les financiers se montrent excessivement prudents et méfiants. La confiance, plus que les faits, guide les décisions dans le monde de la finance. C'est ce qui explique que des banquiers aient pu acheter des actifs comme un chat dans un sac. Le mensonge est présent partout dans le système financier. Les notations des agences de notation sont biaisées, les bilans des banques sont tronqués par les opérations hors-bilan, etc. Or, la confiance et le mensonge ne font pas bon ménage. Des mesures radicales vont devoir être prises pour restaurer la confiance du public dans le secteur financier et les banques en particulier.
3. Les pistes de changement
Comme nous pouvons le constater, de multiples facteurs sont à l'origine de cette crise qui est extrêmement grave et qui sera vraisemblablement longue. L'autorégulation des marchés financiers a conduit au plus grand cataclysme depuis la grande dépression des années 30. Des mesures volontaristes vont devoir être adoptées pour empêcher qu'une telle crise ne se reproduise. Les solutions à la crise devront donc être radicales, durables et nécessairement multiples. Ces solutions, à mettre en débat de façon immédiate aux différents niveaux de pouvoir, doivent reposer sur quatre principes simples:
— meilleure identification du risque;
— limitation du risque;
— plus grande protection contre le risque;
— meilleure gouvernance;
Ces solutions doivent être articulées entre le niveau européen et le niveau belge. La crise actuelle montre clairement qu'une coopération renforcée entre États-membres est nécessaire. Toutefois, l'Europe ne peut servir de prétexte pour ne pas prendre les mesures qui peuvent l'être au niveau national. Plus que jamais, il convient d'appliquer le principe de subsidiarité de manière judicieuse.
La présente proposition de loi vise à poser le premier jalon de ce programme de réformes.
4. L'exemple canadien
À l'instar de la Belgique, le paysage bancaire canadien est dominé par une poignée d'établissements ayant une importance systémique. La comparaison avec le secteur bancaire du Canada est donc tout à fait pertinente.
La réglementation bancaire du Canada peut être citée en exemple comme un modèle de réussite. Grâce à cette réglementation, les banques canadiennes ont des résultats plus stables que leurs homologues étrangers. Les deux graphiques ci-dessous montrent que le rendement des banques canadiennes n'a rien à envier aux banques américaines et européennes et qu'en outre elles ont beaucoup moins souffert de la crise que ces dernières.
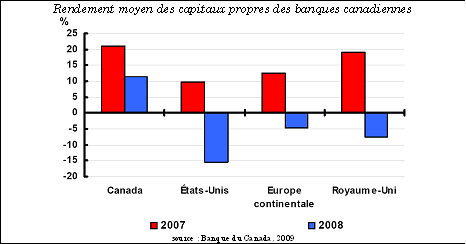
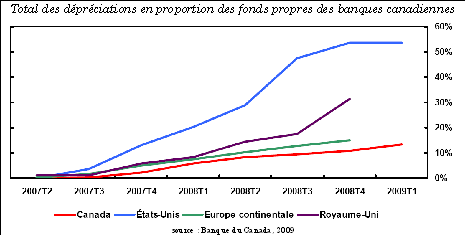
Source: Banque du Canada, 2009
Les dépréciations d'actifs auxquelles ont procédé jusqu'à maintenant les banques canadiennes — qui constituent la principale source de financement au sein de notre économie — ont été relativement limitées, ce qui tient à leurs pratiques rigoureuses en matière de prêt et à leur faible exposition aux instruments adossés à des actifs fortement dépréciés.
Ce qui est caractéristique du secteur bancaire canadien est que les exigences canadiennes de fonds propres dépassent celles de Bâle II. Qui plus est l'appétit pour le risque des banques canadiennes semble limité, car celles-ci conservent des quantités appréciables de fonds propres supérieures aux ratios fixés par le superviseur. Par ailleurs, la titrisation des prêts hypothécaires octroyés par les banques y reste limitée et que les banques gardent dans leur bilan une partie des risques. Enfin, le superviseur des banques impose aussi aux banques un ratio de levier maximal. Ce dernier aspect de la réglementation financière est sans aucun doute celui qui assure le plus de stabilité aux banques canadiennes.
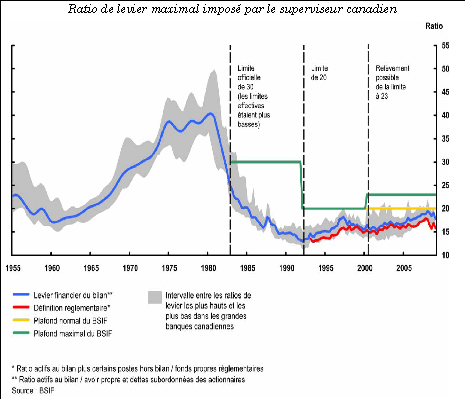
Comme le montre le graphique ci-avant, le levier d'endettement moyen des banques canadiennes se situe autour de 16 %, alors que le plafond normal imposé par le régulateur est fixé à 20. Les banques canadiennes sont donc plus prudentes que ce qu'exige le régulateur.
Si l'on compare cette situation à celle des banques belges, la différence saute aux yeux. Le levier d'endettement moyen (total du bilan/fonds propres) sur la période 2004-2008 était de 36 pour Fortis, 33 pour Dexia et 19 pour KBC. Au regard de l'exemple canadien, les leviers des banques belges sont clairement excessifs, en particulier pour les deux premier cas.
Exprimé autrement, les fonds propres des banques canadiennes s'élèvent en moyenne à 6,25 % du bilan alors que ce ratio ne s'élève qu'à 2,7 % pour Fortis et 3 % pour Dexia.
5. Renforcer la solvabilité des banques de manière contracyclique
La crise actuelle démontre à suffisance que la course irréfléchie aux profits conduit à la catastrophe. Le système bancaire est trop important que pour être laissé en proie aux apprentis sorciers de la finance. Une saine gestion des banques n'est pas nécessairement moins rentable.
Les normes actuelles en matière de fonds propres sont trop faiblement exigeantes. Les nouvelles normes Bâle II ont été améliorées pour tenir compte du risque de crédit, du risque opérationnel et du risque de marché. { fonds propres de la banque > 8 % des [risques de crédits (75 %) + risque de marché (5 %) + risques opérationnels (20 %)] }. Toutefois, les banques établissent leurs propres modèles de risque qui est validé par le régulateur (CBFA en Belgique) et déterminent donc elles-mêmes le niveau de fonds propres nécessaires.
En théorie, depuis Bâle II, les fonds propres sont plus adaptés aux risques. En réalité, les risques sont devenus plus opaques et les fonds propres sont insuffisants face aux risques réels. La preuve en est que de nombreuses banques ont éprouvé ou éprouvent encore de graves problèmes de solvabilité.
Nous pensons qu'il est nécessaire d'instaurer une réglementation plus sévère en matière de fonds propres, à l'instar de ce qui a été appliqué avec succès au Canada et en Espagne. L'instauration d'un système de fonds propres variables en fonction de la conjoncture économique avec un minimum incompressible nous paraît la solution indiquée. Le capital serait la base incompressible fixée à 6 % du passif et les réserves seraient la partie variable en fonction des risques et de la conjoncture économique (4) . Dans les périodes de cycle économique haussier, les banques seraient obligées de provisionner les bénéfices jusqu'à atteindre un niveau de 4 % du total du passif. L'addition de ces réserves au capital s'élèverait à 10 % du passif. L'exigence de fonds propres serait également fonction des risques de crédit, des risques de marché et des risques opérationnels des banques traditionnelles. En période de cycle économique baissier, les exigences en matière de fonds propres seraient assouplies, ce qui laisserait aux banques des marges pour encaisser les pertes en ponctionnant les réserves constituées à cet effet.
Un tel système dynamique est plus efficace que le système actuel. Avec le règlement Bâle II les banques sont obligées de se faire recapitaliser pour compenser des pertes subies et au fur et à mesure que la situation économique se dégrade (les risques perçus augmentent en raison de l'augmentation des défauts de remboursements et par conséquent les exigences de fonds propres). Or, lorsque le contexte économique est dégradé il peut s'avérer très difficile pour une banque de se faire recapitaliser, car les actionnaires ne se bousculent pas pour éponger les pertes. C'est donc vers l'État que les banques se tournent pour être sauvées. Il faut inverser la logique et obliger les banques à se prémunir contre la faillite en période haussière. Le provisionnement dynamique freine la croissance du crédit en période d'expansion économique et freine le rationnement du crédit dû à l'insuffisance des fonds propres durant les récessions.
La présente proposition de loi vise à instaurer un système de fonds propres dynamiques ainsi qu'à renforcer de manière durable la solvabilité des banques. Compte tenu de la situation financière critique dans laquelle se trouvent les banques actuellement, il serait inopportun d'imposer une contrainte supplémentaire aux banques à court-terme. Pour cette raison, la présente proposition de loi prévoit une période de transition de sept ans.
Article 2
Le paragraphe 1er de l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remanié afin d'instaurer un système de fonds propres variables en fonction de la conjoncture économique avec un minimum incompressible de 6 % du total du bilan.
L'objectif de ce nouvel alinéa est que les fonds propres des établissements de crédit atteignent d'ici le 1er janvier 2017 au plus tard 10 % du total de leur bilan. Les réserves à constituer à hauteur de 4 % du total du bilan ont pour but de compenser des pertes opérationnelles éventuelles des établissements de crédit.
L'autorité de surveillance — c'est-à-dire la CBFA ou la Banque nationale de Belgique — adoptera un règlement précisant les modalités d'application de la nouvelle disposition, qui définira notamment les critères selon lesquels les réserves pourront varier en fonction de la conjoncture économique et d'autres facteurs pertinents. Le terme d'autorité de supervision a été choisi, car certaines missions actuelles de la CBFA vont être confiées à terme à la BNB.
| José DARAS Freya PIRYNS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un alinéa 3 est ajouté à la fin du § 1er de l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit:
« Nonobstant ce qui précède, le capital des établissement doivent s'élever à tout moment à au moins 6 % du total du bilan de l'établissement de crédit. En outre, les établissements de crédit doivent progressivement constituer des réserves à hauteur de 4 % du total du bilan.
L'autorité de surveillance détermine, par voie de règlement, les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. L'autorité de surveillance peut établir des normes plus sévères pour les établissements dits systémiques, ainsi qu'une période de transition jusqu'au 1er janvier 2017. »
10 février 2010.
| José DARAS Freya PIRYNS. |
(1) Rapport préliminaire du collège d'experts remis à la Commission spéciale chargée d'examiner la crise financière et bancaire, 10 avril 2009, p. 32.
(2) Article 43, §§ 1 et 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(3) Article 43, § 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(4) Actuellement les exigences de fonds propres sont exprimés par rapport aux risques pondérés et non par rapport au total du bilan.